Ce que je cherche à prouver sans m’en rendre compte
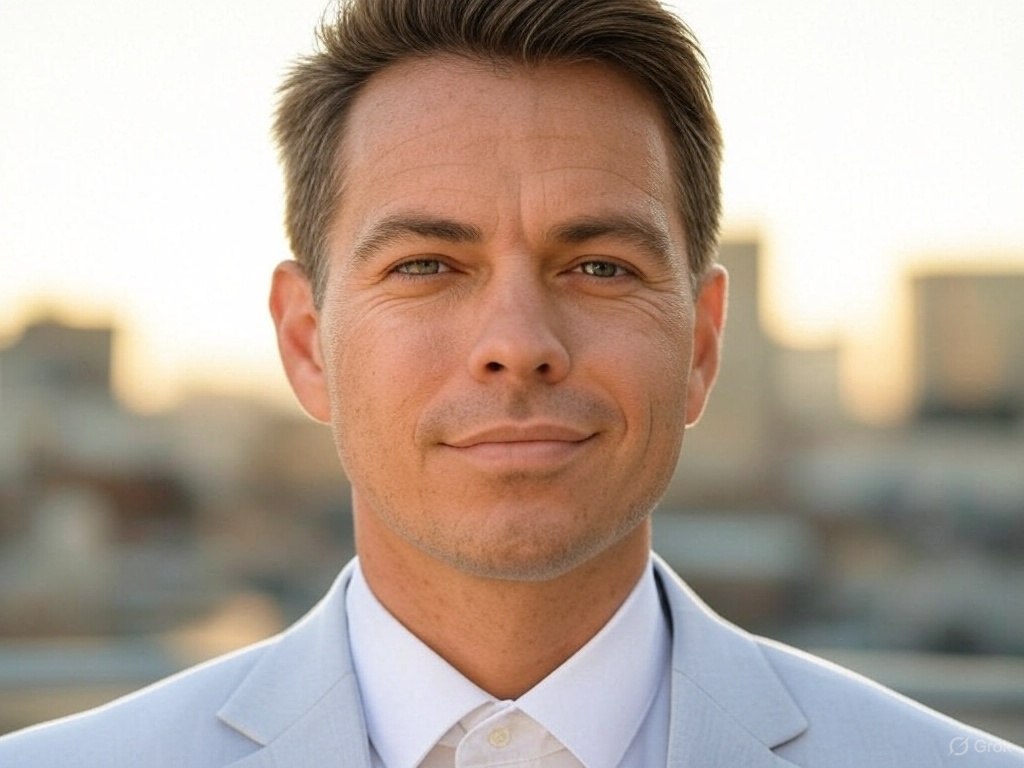
Dans nos efforts, nos choix, nos façons d’aimer ou de réussir, il y a parfois un moteur invisible : prouver quelque chose. À soi-même, à un parent, à un regard du passé. Sans le dire, sans en être toujours conscient, on agit pour se justifier, se réparer, ou se faire reconnaître. Ce besoin de prouver n’est pas un caprice : c’est souvent une tentative de combler un vide, de panser une blessure, ou de répondre à une attente ancienne. Que cherchons-nous à prouver, et pourquoi ? Et surtout, à qui ?
Le besoin de prouver : un symptôme d’un manque intérieur
Vouloir prouver, ce n’est pas simplement vouloir réussir ou exister aux yeux des autres. C’est souvent tenter de remplir un espace intérieur fragile. Une blessure d’abandon, une dévalorisation précoce, une parole non dite peuvent laisser un sentiment diffus d’illégitimité. Le sujet ne se sent pas « assez » ; et cherche donc à faire plus, être plus, donner des preuves visibles d’une valeur intérieure incertaine. Cette quête peut être infatigable, mais aussi épuisante.
Prouver à qui, exactement ?
Dans une lecture psychanalytique, ce que l’on cherche à prouver dans le présent renvoie souvent à une figure du passé. Un parent froid, exigeant ou absent. Un enseignant humiliant. Un frère brillant. Parfois, ce « témoin intérieur » n’existe même plus… mais il continue à vivre dans le psychisme comme un juge silencieux. On continue d’agir « pour lui montrer », « pour se venger », « pour enfin être vu ». Ce déplacement est inconscient, mais il structure des choix, des ambitions, des doutes. Et l’on court après une reconnaissance qui, en réalité, ne viendra pas de là.
L’illusion réparatrice de la performance
Réussir peut donner l’illusion, un instant, que la blessure est comblée. Mais souvent, elle revient, déplacée, sous une autre forme. Car ce que l’on cherche à prouver est lié à une histoire, pas à un résultat. Et tant que cette histoire reste enfouie, les actes viennent la rejouer, non la réparer. On accumule les preuves extérieures, sans jamais se sentir pleinement validé·e. C’est dans cette répétition que peut se loger un symptôme silencieux, voire un surinvestissement professionnel, affectif ou moral.
Vers une autre légitimité
Le seul chemin durable passe par la reconnaissance de ce mécanisme ; non pour s’en vouloir, mais pour en sortir. Nommer ce que l’on cherche à prouver, identifier à qui cela s’adresse, et accepter que la reconnaissance profonde ne viendra pas du passé, mais de soi, dans le présent. C’est en cessant de convaincre l’autre qu’on commence à s’écouter soi-même. Une démarche souvent lente, parfois douloureuse, mais essentielle pour retrouver une forme de liberté intérieure.

