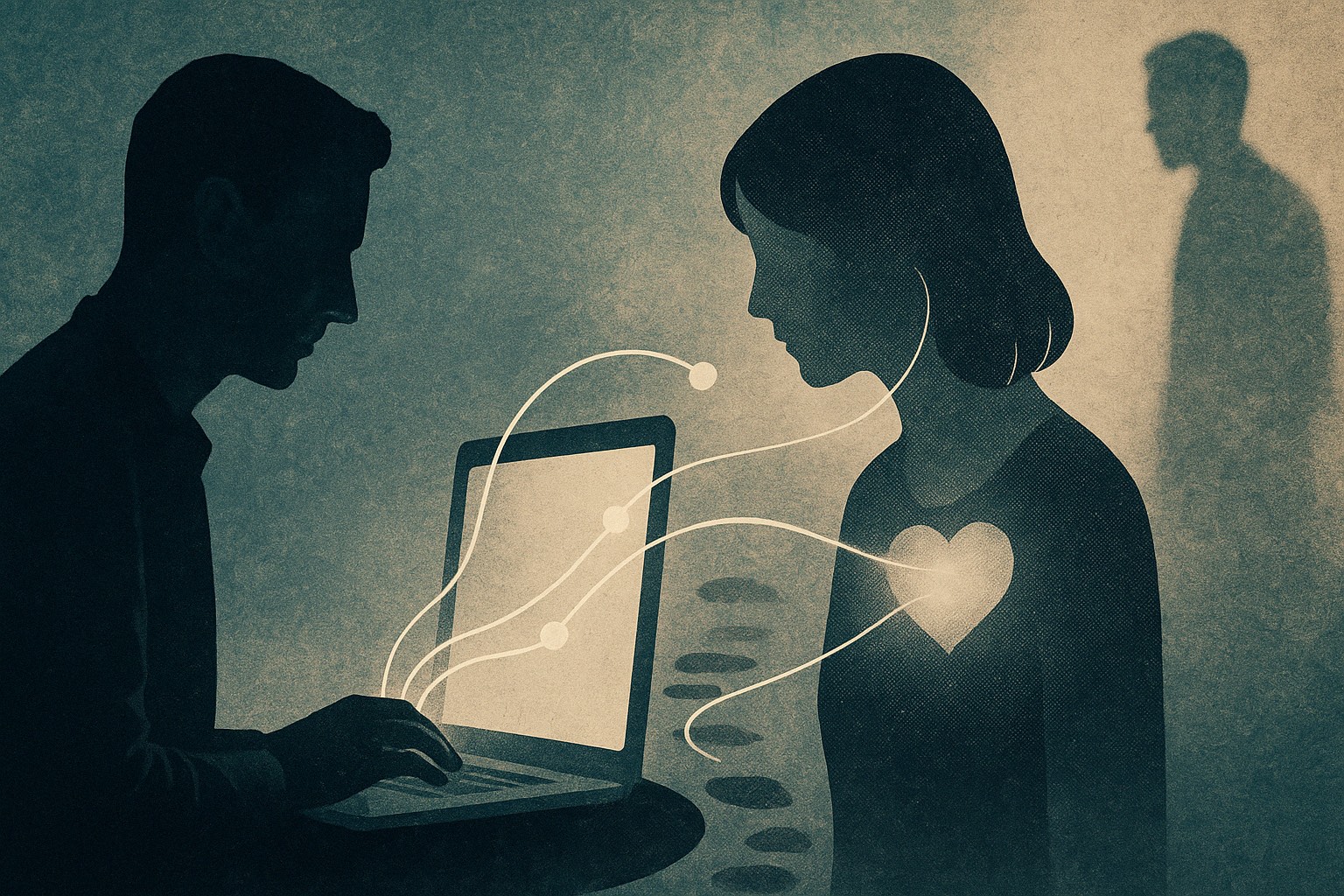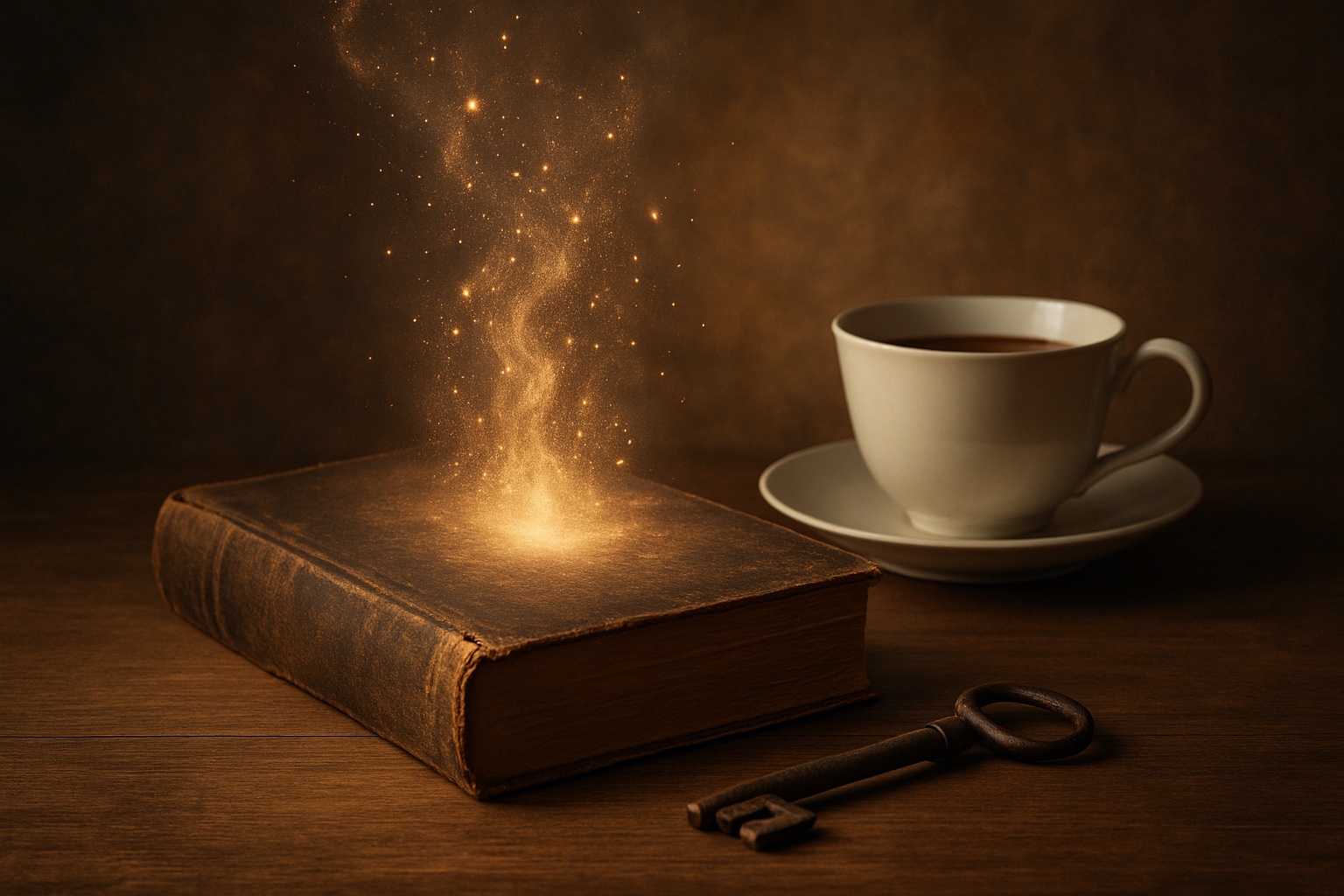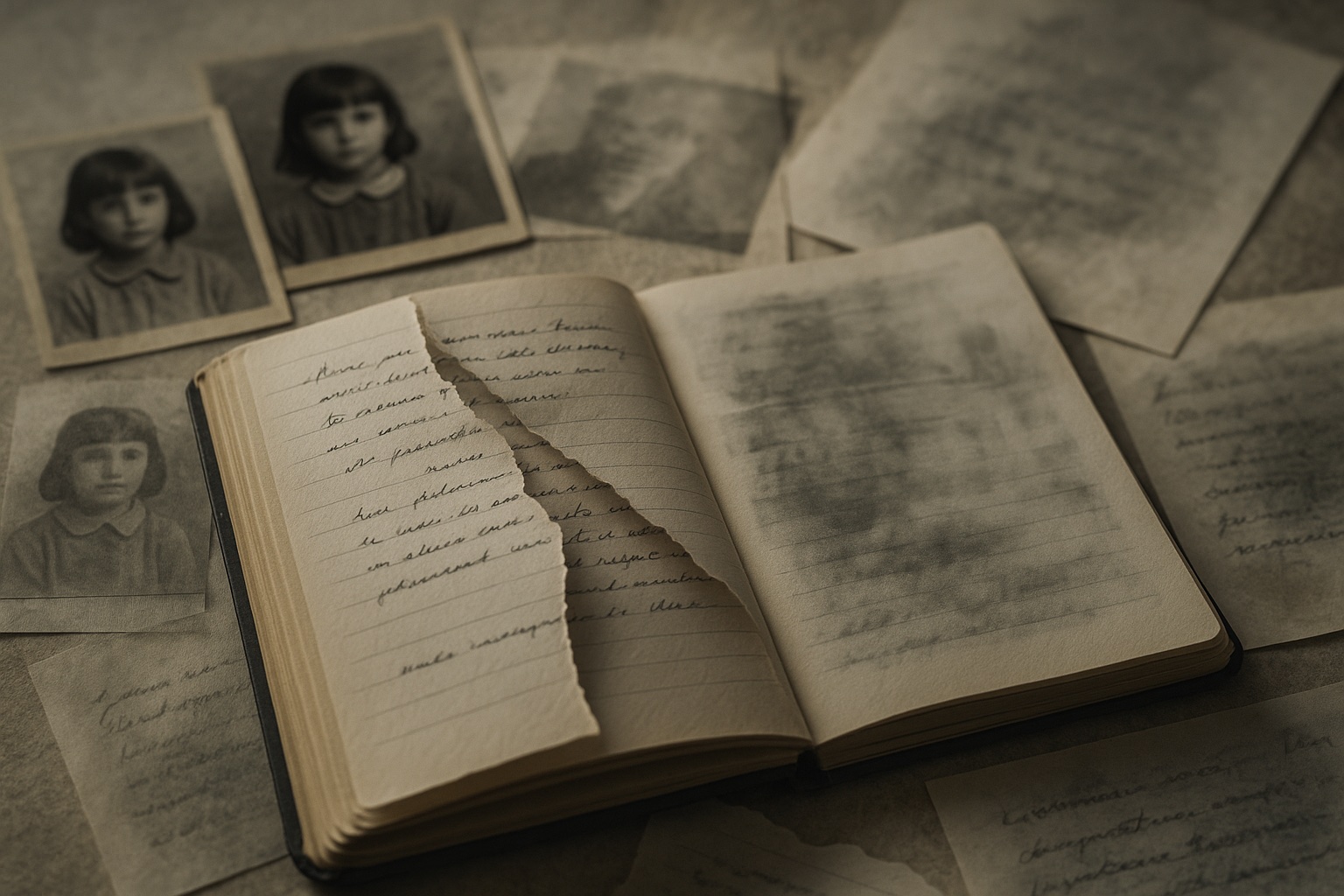Pourquoi nous répétons toujours la même histoire
Se retrouver, encore et encore, dans les mêmes situations. Tomber amoureux du même type de personne. Revivre le même conflit, reproduire les mêmes échecs. Beaucoup d’entre nous ont l’impression de revivre toujours la même histoire, malgré les efforts pour changer. Cette sensation n’est pas une coïncidence : elle renvoie à un mécanisme inconscient de répétition, bien connu en psychanalyse. Il ne s’agit pas de malchance, ni d’un simple défaut de volonté, mais d’un appel intérieur à revivre ce qui n’a pas pu être élaboré. Pour en sortir, il faut d’abord en comprendre le sens profond. La compulsion de répétition : un paradoxe inconscient En psychanalyse, la répétition n’est pas un…
Peut-on tout remettre en question ?
Il y a des moments dans la vie où tout vacille. Ce que l’on croyait stable ne l’est plus. Ce…
Traumatismes psychiques et résilience : un long chemin
Un traumatisme psychique ne se voit pas toujours. Il ne laisse ni bleu ni cicatrice apparente, mais il agit comme…
Ai-je besoin d’être aimé(e) pour m’aimer ? Le poids du regard extérieur
Le regard des autres nous touche. C’est humain. Mais parfois, il devient un prisme à travers lequel on se juge…
L’importance des amitiés quand on est célibataire
Quand on parle de lien, c’est souvent l’amour romantique qui prend toute la place. Pourtant, les amitiés jouent un rôle fondamental dans l’équilibre affectif, encore plus quand on traverse une période de célibat. Elles ne sont pas une consolation, ni un substitut : elles sont un socle. Les liens d’amitié offrent une présence stable, libre, souvent moins conditionnée que les relations amoureuses. Un espace sans enjeu de performance Dans l’amitié, il n’y a pas d’attente de couple, pas de projection d’avenir conjugal, pas de rôle à jouer. Cela permet souvent une parole plus libre, une présence plus décontractée, une fidélité au quotidien. C’est un lien où l’on peut être pleinement soi, sans avoir à "réussir"…
Acheter ensemble : investissement ou mise à l’épreuve du lien ?
Quand l’engagement matériel devient un révélateur des sécurités et des insécurités affectives. Acheter un bien à deux n’est jamais une simple démarche financière. Au-delà de l’acte concret, il symbolise une projection, un ancrage, une volonté commune de construire. Mais ce geste, souvent valorisé socialement comme…
Couple : comment établir la confiance ?
Les fondations invisibles d’un lien solide et vivant La confiance est souvent évoquée comme un prérequis dans toute relation amoureuse. Pourtant, elle ne se décrète pas, ne s’exige pas, et ne s’installe pas spontanément. Établir la confiance, c’est construire un espace psychique où chacun peut…
L’infidélité virtuelle : trahir sans toucher, est-ce tromper ?
Quand le digital redéfinit les frontières de la fidélité Avec l’omniprésence des réseaux sociaux, des messageries et des applications, l’infidélité a trouvé de nouveaux terrains, immatériels mais bien réels. Séduire, flirter ou entretenir des échanges ambigus derrière un écran questionne profondément la notion même de…
Comment l’histoire familiale influence le rôle parental
Devenir parent, ce n’est pas seulement éduquer un enfant selon ses choix conscients ; c’est aussi, souvent sans le savoir,…
Les secrets d’enfant : ce qu’ils taisent pour protéger leur monde intérieur
Face à un enfant qui murmure à l’oreille d’un camarade ou refuse obstinément de révéler ce qu’il cache, l’adulte est…
Grands-parents et transmission : que lègue-t-on vraiment ?
La mémoire familiale ne se limite pas aux objets et aux récits ; elle porte aussi l’empreinte invisible de l’inconscient…
Éducation de l’enfant : injonctions ou suggestions ?
L’éducation est souvent perçue comme un cadre à poser, des règles à faire respecter. Pourtant, la manière dont ces règles sont transmises joue un rôle décisif dans la façon dont l’enfant les intègre. Entre l’injonction autoritaire et la suggestion bienveillante, se dessine un espace où l’enfant peut apprendre à coopérer plutôt qu’à obéir sous contrainte. Ce choix subtil influence non seulement le comportement immédiat mais aussi la construction de l’autonomie et de la confiance. L’injonction : efficacité immédiate mais fragile Dire à un enfant « Range ta chambre maintenant » impose une action sans laisser place à l’adhésion. Si l’injonction peut obtenir un résultat rapide, elle repose souvent sur une dynamique de rapport de force. L’enfant obéit par crainte de…
Expliquer son métier : une clé pour exister socialement
À première vue, expliquer son métier semble anodin. Il s’agirait simplement de décrire ce que l’on fait, comment, et pourquoi. Pourtant, ce geste apparemment fonctionnel engage bien plus que de l’information. Dire…
Comment les médias malmènent la complexité
À l’heure de l’instantané, l’accès à une parole nuancée dans les médias grand public semble inégalement distribué. Loin de toute intention malveillante, c’est souvent la contrainte des formats, des rythmes et des…
La télévision comme refuge : images douces pour monde dur ?
Dans un contexte d’incertitude sociale, économique et écologique, la télévision revient comme un îlot familier. Émissions rassurantes, séries confortables, visages connus : elle offre une forme de présence stable, à rebours de…
Regarder sans choisir : la télévision linéaire comme confort de passivité
À l’heure du numérique et des plateformes à la demande, la télévision linéaire peut sembler archaïque. Et pourtant, elle conserve une audience stable, voire fidèle. Ce paradoxe s’explique moins par l’attachement à…
Être indispensable : la peur inconsciente de disparaître
Certaines personnes s’investissent avec une intensité constante dans leur association, leur collectif ou leur groupe d’entraide. Elles sont toujours là, toujours disponibles, toujours prêtes à répondre, à organiser, à porter. Derrière cette présence irréprochable se cache parfois une peur plus ancienne : celle de ne plus exister si l’on cesse d’être nécessaire. Être utile devient un mode d’ancrage identitaire, une réponse au vide intérieur et une protection contre l’effacement subjectif. Être celui ou celle qu’on ne peut pas remplacer Le besoin d’être indispensable n’est pas seulement lié à la conscience professionnelle ou à la générosité. Il renvoie souvent à une angoisse plus primitive : si je ne sers à rien,…
Quand l’engagement associatif masque une fuite du conflit familial
Il n’est pas rare que certaines personnes trouvent dans une association une forme de foyer psychique, un sentiment de place,…
Pourquoi les liens se rompent toujours au même moment ?
Certaines personnes revivent, sans le vouloir, des scénarios relationnels étrangement similaires : une rencontre pleine de promesses, une proximité naissante,…
Solitude et idéal du moi : rester seul pour ne pas être déçu de soi
À première vue, rester seul peut sembler relever d’un goût personnel ou d’une quête d’indépendance. Mais dans certaines configurations psychiques,…
Ne jamais s’opposer à son chef : une peur de perdre l’amour du dominant ?
Certaines personnes ne contestent jamais leur supérieur. Elles acquiescent, s’adaptent, cherchent à comprendre, même lorsque les décisions semblent discutables. Cette attitude peut être interprétée comme une preuve de loyauté, de souplesse, voire d’intelligence relationnelle. Mais chez d’autres, elle trahit une peur plus profonde : celle de perdre une place privilégiée dans le regard du chef, d’être exclue du lien, abandonnée ou invisibilisée si un désaccord venait à troubler l’équilibre. L’adhésion devient alors une stratégie affective d’attachement, bien plus qu’un choix professionnel. Une soumission affective déguisée Dans ces cas, le chef ne représente pas seulement une autorité fonctionnelle, mais une figure d’étayage narcissique, dont la reconnaissance est vitale. Le moindre signe de distance est perçu comme…
Le formateur comme figure de transfert : guide, parent ou rival ?
Dans toute situation d’apprentissage, il existe une dynamique visible — celle de la transmission de savoir — et une dynamique plus souterraine : celle du transfert. Le formateur n’est jamais seulement un enseignant. Il devient, souvent à son insu, le support d’une projection affective inconsciente qui…
Se diriger vers des études prestigieuses, une quête d’amour parental ?
Choisir une grande école, intégrer une filière réputée, viser l’excellence… autant de décisions souvent perçues comme des marqueurs de réussite, de mérite, de légitimité sociale. Mais pour certain·es, l’attrait pour les études prestigieuses cache moins un désir personnel qu’un espoir de reconnaissance familiale. Ce n’est…
Quand le silence devient stratégie : les enjeux du salarié discret
Certain·es salarié·es s’effacent dans les réunions, parlent peu en open space, ne revendiquent ni leurs mérites ni leurs limites. Ils ne dérangent pas, ne s’imposent pas, ne dévient pas. On les décrit comme « discrets », « posés », « professionnels », parfois « transparents…
Quand tout fatigue : comprendre l’épuisement psychique
Il arrive que l'on se sente vidé, sans cause identifiable. Ni maladie physique, ni événement dramatique, ni surmenage évident. Simplement, une fatigue étale, continue, sans point d’appui. Ce type d’épuisement psychique, souvent minimisé, peut être…
L’obsession de la pleine conscience : une angoisse de perte de contrôle ?
Pratiquer la pleine conscience, c’est vouloir être là, attentif à l’instant, ancré dans le réel. Sur le papier, cette intention semble saine, voire libératrice. Mais pour certains, la pratique se durcit, se répète, devient rigide.…
Flotter au spa : le lâcher-prise aquatique comme métaphore du lien perdu
Le corps flottant dans l’eau n’est plus soumis aux lois habituelles : il est soutenu sans effort, libre de ses tensions, doucement désorienté. Ce moment, souvent vécu comme anodin ou agréable, peut pourtant réveiller une…
Se confier à son médecin : une intimité privilégiée ?
La consultation médicale n’est pas toujours un simple échange de données cliniques. Dans ce cadre formel, balisé, limité dans le temps, surgit parfois une parole inattendue, plus intime, plus vraie. Certaines personnes racontent à leur…
Chercher un guide sans le dire : quand le besoin de direction reste inavoué
Certaines personnes arrivent en thérapie avec une posture d’indépendance affichée, une volonté de « réfléchir », d’« explorer ». Pourtant,…
Redouter de décevoir en séance : que cache cette peur de mal faire ?
On n’y pense pas toujours, mais pour beaucoup de patients, venir en séance n’est pas un simple rendez-vous neutre. C’est…
Se sentir spécial pour son psy : que dit cette attente de reconnaissance ?
Dans le silence feutré du cabinet, quelque chose se noue parfois sans être dit. Le regard, l’attention, la régularité des…
Tout m’agace : irritabilité chronique ou douleur déplacée ?
Ce n’est pas une colère explosive, mais une tension continue. Un agacement quotidien, face à tout et à rien. Une impatience latente, une crispation sourde. On s’emporte pour des détails, on soupire, on rumine. Et pourtant, rien de vraiment grave ne semble l’expliquer. Cette irritabilité chronique, si fréquente et pourtant peu interrogée, peut être le masque d’un autre affect plus enfoui. Derrière ce ton sec ou ces nerfs à vif, c’est souvent une autre douleur qui cherche à se faire entendre, à travers un chemin détourné. La colère comme écran d’une fragilité intérieure L’agacement est un affect plus tolérable que d’autres. Il permet d’exprimer une tension sans en dévoiler la source. Mieux vaut paraître irritable que vulnérable, sec que triste.…
Écriture : la charge symbolique des objets dans les récits d’enfance
Dans bien des récits d’enfance, ce sont les objets qui agissent comme déclencheurs de la mémoire. Une boîte oubliée, un vêtement jauni, un parfum ancien suffisent à faire resurgir un monde affectif enfoui. Ces objets ne sont pas de simples accessoires : ils portent une charge symbolique puissante. Ils condensent…
Quand l’écriture échoue à apaiser l’enfance
L’écriture de l’enfance est souvent pensée comme un geste de réparation : mettre en mots les blessures, les pertes, les conflits serait un moyen de les transformer, de les apaiser. Pourtant, certains récits révèlent les limites de ce travail symbolique. Il arrive que l’écriture, loin de pacifier le passé, en…
Trop-plein visuel : quand l’abondance d’œuvres devient étouffante
Entrer dans une exposition, c’est souvent espérer s’ouvrir à l’émotion, à la beauté ou à la pensée. Mais parfois, à peine quelques salles parcourues, une sensation inattendue s’installe : lassitude, agitation intérieure, voire malaise. Trop d’œuvres, trop d’images, trop de textes, trop d’attente. Le regard se fatigue, l’esprit décroche. Ce…
Face aux regards : malaise ou besoin d’être vu au musée ?
Le musée est un lieu d’observation. On y regarde les œuvres, mais aussi les autres. On y est vu en train de regarder. Ce va-et-vient du regard, à la fois discret et permanent, façonne l’expérience de visite. Certains s’y sentent observés, jugés ou dévisagés. D’autres, au contraire, cherchent ce regard…